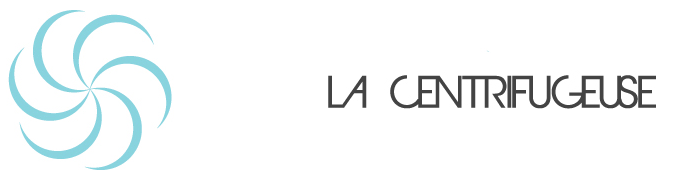Trio blues-rock solide qui fait trembler les scènes internationales, Delgres, c’est aussi un tournant dans une carrière, celle du guitariste-chanteur Pascal Danaë qui après un long cheminement a pioché dans ses influences éparses, entre les caraïbes et le Mississippi. Avec la sortie de son premier album, cette formation singulière ne pouvait que susciter la curiosité : micro tendu vers le leader du groupe pour tenter de mieux comprendre ce point de confluence.
Pourquoi ce nom pour le groupe ?
Delgres, c’est une manière de mettre en lumière un héros oublié de la lutte contre l’esclavage. Louis Delgres, c’était un officié de Napoléon métisse qui était né à la Martinique mais en garnison à la Guadeloupe en 1802 au moment où Bonaparte a voulu rétablir l’esclavage dans les Antilles françaises. Louis Delgres s’est battu au mois de mai 1802 contre les troupes françaises, et comme ils étaient en sous nombre, il savait qu’il était perdu et s’est retranché dans une habitation à Matouba, il a décidé d’attendre que les français arrivent, il a miné tout le fort et fait exploser toute l’habitation, avec les français qui étaient là, et évidemment lui et ses 300 compagnons. C’était quelqu’un qui s’était battu pour la révolution française, il y avait énormément de soldats de couleur, des métisses qui avaient intégré l’armée, ils croyaient fermement en l’idéal de la révolution, vivre libre ou mourir, le grand-père d’Alexandre Dumas faisait partie de ces personnes par exemple. Avant que le groupe existe tel qu’il est aujourd’hui, j’avais une première chanson pour lui rendre hommage, cette chanson aujourd’hui s’appelle Mo Jodi, qui veut dire mourir aujourd’hui, elle donne aussi son nom à l’album. On a trouvé que cette chanson représentait assez bien l’idéal de liberté et le fait d’avoir des convictions profondes à défendre jusqu’au bout.
Comment vous êtes-vous rencontré ?
A une époque, je vivais à Amsterdam, et j’avais commencé à faire un travail personnel sur mon identité, j’étais tombé très amoureux de la musique blues quelques années auparavant mais sans toutefois oser rentrer dedans, parce que je trouvais que plein de gens faisaient ça très bien, et puis moi-même n’étant pas américain, je me disais, quelle légitimité pour faire ça ? J’étais à un moment de ma vie où je remettais un pied devant l’autre, et on m’a offert une guitare Dobro, magnifique, qui portait en elle tout ce que j’aimais bien dans le blues, j’ai commencé à faire un peu de slide. Ma quête d’identité m’a poussé à rechanter en créole, car j’avais arrêté pendant quelques temps. J’écris quelques chansons, je rentre à Paris, et là je me dis « il faut que j’arrive à étendre ça ». A ce moment-là, je faisais partie d’un groupe qui s’appelait Rivière Noire, avec Baptiste Brondy, batteur avec qui j’avais une connexion très forte, je l’ai appelé pour monter Delgres, puis on a contacté Raphael (alias Rafgee) qui est venu jouer du sousaphone avec nous.
Cette esthétique blues-rock, c’était voulu dès le départ ?
J’adore Skip James, le coté rural, j’aime les vieux enregistrements, il y a quelque chose d’habité dans ce vieux son, la guitare Dobro amène naturellement vers ça, quand le groupe a commencé à jouer, c’était juste cet esprit là mais un peu plus fort avec notre son.
Jusqu’à maintenant, certains médias ont évoqué The Black Keys en comparaison avec votre musique, est-ce que c’est une influence que vous revendiquez ?
Disons que ce n’est pas une influence mais on sent une parenté. Ce qui est intéressant chez eux, et ce que on apprécie, c’est la recherche du grain et du son vintage, ils ont un peu remis au gout du jour ce côté low-fi, des sons un peu caverneux avec des vieilles réverb. C’est quelque chose que l’on a aussi essayé de faire sur notre album mais tout en restant dans notre esthétique à nous, avec l’élément caraïbe.
Le chant en créole, c’était une évidence dès le début du groupe ?
C’était quelque chose de très introspectif, au moment où j’ai commencé à écrire les toutes premières chansons, je me foutais complétement de savoir si ça allait sortir ou pas, je faisais juste ça pour moi. Je prenais ma guitare, je fermais les yeux, je pensais aux vieux bluesmen, aux chanteurs de gwo ka de la Guadeloupe, ce sont des gens qui chantent quoi qu’il arrive, je me sentais en connexion avec ça.
A propos de votre titre Mr Président, est-ce que pour vous le blues a une dimension clairement politique ?
Il y a une dimension politique, justement parce que ça ne l’est pas, on ne montre pas du doigt, il y a plusieurs niveaux d’écoute, y compris essayer de comprendre le sens caché de ce qui est dit, il y a un côté miroir dans cette musique, ce n’est pas intrusif.
Au-delà de la langue, est-ce qu’il y a d’autres influences des caraïbes dans votre album ?
C’est un voyage, le point de départ c’est l’encrage blues-rock qui est très fort, et puis il y a quelques chansons plus lumineuses, notamment Serrer Moi Plus Fort dans laquelle on a invité Skye Edwards, la chanteuse de Morcheeba, c’est elle qui a voulu chanter ça avec nous, et elle chante en créole d’ailleurs. Je connais ce groupe depuis l’époque où je vivais à Londres, et ils nous ont invité à faire leur première partie, on chantait cette chanson, et un soir Skye vient nous voir et nous demande si elle peut chanter cette compo avec nous, on était vraiment ravie, c’est un groupe d’une gentillesse et d’une humilité incroyable. Il y a un autre titre sur notre album dans le même esprit qui se nomme Vivre Sur La Route dans lequel on parle de ce que l’on a vécu entre 2016 et maintenant, car on n’a pas arrêté de tourner, dans cette chanson on parle notamment du manque de la famille.
Interview réalisé par Hugues Marly au festival Rio Loco, Toulouse. Juin 2018.
Album “Mo Jodi” (Pias) - Sortie le 31.08.18